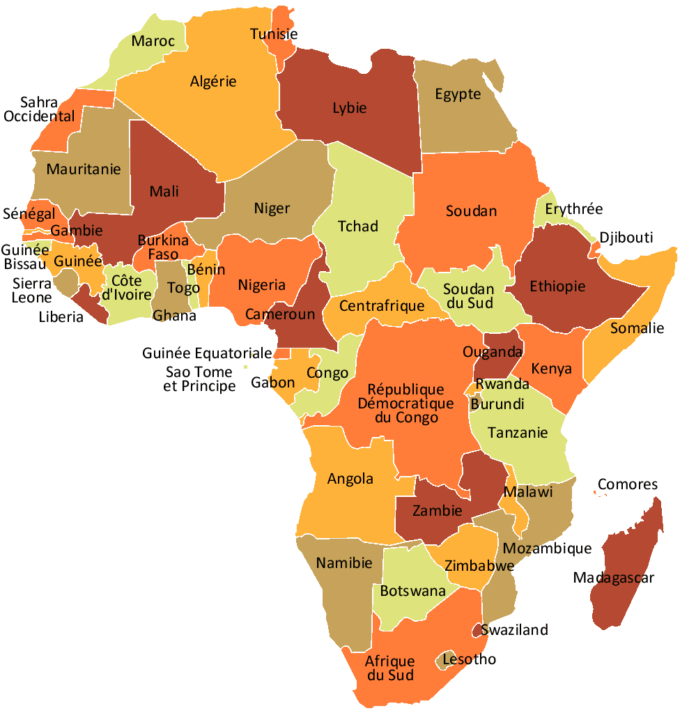Fiacre VIDJINGNINOU, PhD Sociologie Politique – Militaire, Chercheur associé au Behanzin Institute
Depuis 2020, l’Afrique de l’Ouest assiste à un spectacle inquiétant : au nom de la sécurité et de la souveraineté du peuple, des régimes militaires défont méthodiquement les piliers de la démocratie. Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée…presque partout, les juntes au pouvoir avancent, masquées sous la promesse d’une transition vers le changement ou la révolution, mais œuvrent en réalité à la disparition organisée de l’espace politique. Leur arme ? Pas le canon, mais un stérile vent de paroles sous lequel est orchestrée une stratégie froide, insidieuse, calculée pour étouffer le pluralisme.
Méthodique est l’entreprise d’émasculation de la démocratie en cours dans les régimes militaires en Afrique de l’Ouest. Premier acte : après avoir descendu les régimes civils, neutraliser les partis politiques. Dans chaque pays tombé sous le joug militaire, la séquence est identique. On commence par décrédibiliser les partis, accusés de tous les maux : corruption, inefficacité, tribalisme… Puis on suspend leurs activités, on les marginalise, ou on les dissout.
Au Mali, le coup d’État d’août 2020 a ouvert une séquence de glissements successifs. Les élections promises pour février 2022 ont été repoussées à février 2024, puis renvoyées aux calendes. En mars 2024, le pouvoir convoque des « assises nationales sur l’avenir des partis politiques » — comprendre : comment les enterrer proprement sous un vernis de légitimité populaire.
Au Niger, le scénario est plus direct. Le 26 mars 2024, le général Abdourahamane Tiani dissout par ordonnance l’ensemble des partis politiques et s’autoproclame président pour cinq ans renouvelables. Le décor est planté : plus de jeu politique, plus d’opposition, plus d’alternance. En prime, l’homme s’octroie une promotion express, bondissant de général de brigade (deux étoiles) à général d’armée (cinq étoiles), sans autre mérite que celui d’avoir renversé un pouvoir élu. La promotion par le putsch est devenue la norme dans la région, une inflation galonnée qui dit tout de l’ivresse du pouvoir militaire. Seul le Burkinabè déroge à la règle : Ibrahim Traoré, figé dans une posture sankariste jusqu’à l’excès, conserve son grade de capitaine comme on brandit un talisman révolutionnaire.
Mais sous l’uniforme, le discours est le même. À Ouagadougou, la vie politique est suspendue depuis 2022. Et le 1er avril 2024, Traoré enfonce le clou : « Il est étonnant que des intellectuels pensent qu’un pays peut se développer dans la démocratie. » Ce n’est plus du cynisme : c’est une idéologie d’État. Une doctrine assumée pour liquider ce qui reste encore de la démocratie dans ces pays.
Ce que ces hommes mettent en œuvre, c’est la neutralisation programmée de toute alternative politique. Comme l’expliquait le politiste Guillermo O’Donnell, les régimes autoritaires n’ont pas besoin de fusiller les urnes : il leur suffit d’user jusqu’à la corde les mécanismes de participation, jusqu’à les rendre inopérants. Dissoudre les partis, c’est tuer la démocratie.
Un pouvoir sans partage, maquillé en salut national
Au-delà des partis politiques, espaces de formation de l’esprit démocratique par excellence, les nouveaux maîtres en kaki concentrent les principaux leviers du pouvoir, contrôlent les médias, musèlent la critique. Pour durer au pouvoir sans passer par l’épreuve des élections, il faut d’abord faire taire ceux qui pourraient les réclamer. Voilà pourquoi les partis sont dissouts. Voilà pourquoi les médias sont encadrés. Voilà pourquoi la société civile est intimidée. L’espace politique est vidé, aseptisé. Ne restent que les voix loyales, les clameurs d’allégeance, les relais cooptés.
Pour faire passer la pilule, ces régimes parlent de « transition », de « refondation », d’« assises nationales ». Une transition sans échéance n’en est pas une. Les promesses de transition ne constituent qu’une fiction commode pour suspendre les droits, reporter les élections, verrouiller le débat. En réalité, la transition est le nom de leur régime politique. Elle n’est plus un passage, un moyen pour rétablir la République mais une fin en soi. Comme l’a écrit Marcel Gauchet : « la démocratie peut être détruite en prétendant la réformer ». À vouloir refonder, ces régimes enterrent les acquis démocratiques. À force de suspendre, ils finissent par supprimer l’essentiel, l’espace vital du peuple.
Pourtant, c’est du déjà vu !
Caractéristique majeure de leur gouvernance : parler au nom du peuple et pour le peuple. Ils n’ont que cela à la bouche : le peuple. Une gouvernance cousue de populisme et qui laisse le peuple crever. Comme le disait Pierre Rosanvallon, le populisme politique réduit le politique à une voix unique, supposément pure, celle du peuple — mais une voix confisquée par un pouvoir autoritaire. C’est exactement ce que prétendent être ces chefs militaires : l’expression brute du peuple, débarrassée de ses médiations démocratiques. En s’érigeant en représentants naturels de la nation, ils se voient comme seuls capables d’assurer l’ordre, la sécurité, la grandeur nationale, reprenant ainsi une tradition prétorienne où l’armée se pose en ultime rempart contre le ‘’désordre civil’’ (Samuel Huntington).
Sauf que, l’Afrique de l’Ouest a déjà connu cet activisme prétorien dans les années 60 à 90 avec des figures plus emblématiques que celles d’aujourd’hui. A ceux qui s’extasient sur les promesses mirifiques de ces régimes militaires, il convient de dire sans ambages que l’Afrique de l’Ouest n’a pas besoin d’une nouvelle poussée prétorienne, despotique. Elle l’a éprouvée durement par le passé sur des décennies avec un bilan honteux en termes de banqueroute économique, de désastre dans les finances publiques, de tortures physiques et de décadence morale.
L’Afrique de l’Ouest face à son destin
Ces juntes ne sont pas des accidents de l’histoire, ni de simples gestionnaires de crise. Ce sont des prédateurs politiques qui cherchent à transformer le pouvoir transitoire en souveraineté définitive dans leurs mains. Leur ambition n’est pas la restauration de la démocratie : c’est l’autoritarisme par une lente asphyxie de l’opinion publique.
Ce qui se joue aujourd’hui au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ailleurs, ce n’est pas une parenthèse autoritaire. C’est une réingénierie du pouvoir, un projet de refondation illibérale, hostile au pluralisme, méfiant envers la liberté, imperméable à l’alternance. Loin d’être des sauveurs, ces régimes sont les fossoyeurs de la République, de la démocratie.
Et pendant que le monde regarde ailleurs, pendant que la CEDEAO hésite, pendant que les opinions publiques, épuisées, se replient, la démocratie meurt à petit feu. Sans coups de feu. Sans grand fracas. Mais avec méthode.
Il est encore temps d’ouvrir les yeux. De dénoncer ce qui est à l’œuvre. De dire que le silence, dans ces circonstances, vaut complicité. « Le silence est la forme la plus redoutable du consentement » (Albert Camus). L’Afrique de l’Ouest mérite mieux que des régimes d’exception déguisés en gouvernements de salut national. Elle mérite des institutions solides, des contre-pouvoirs vivants, des citoyens debout et un franc devoir de mémoire pour dire hardiment que le despotisme n’a jamais été seyant pour l’Afrique.