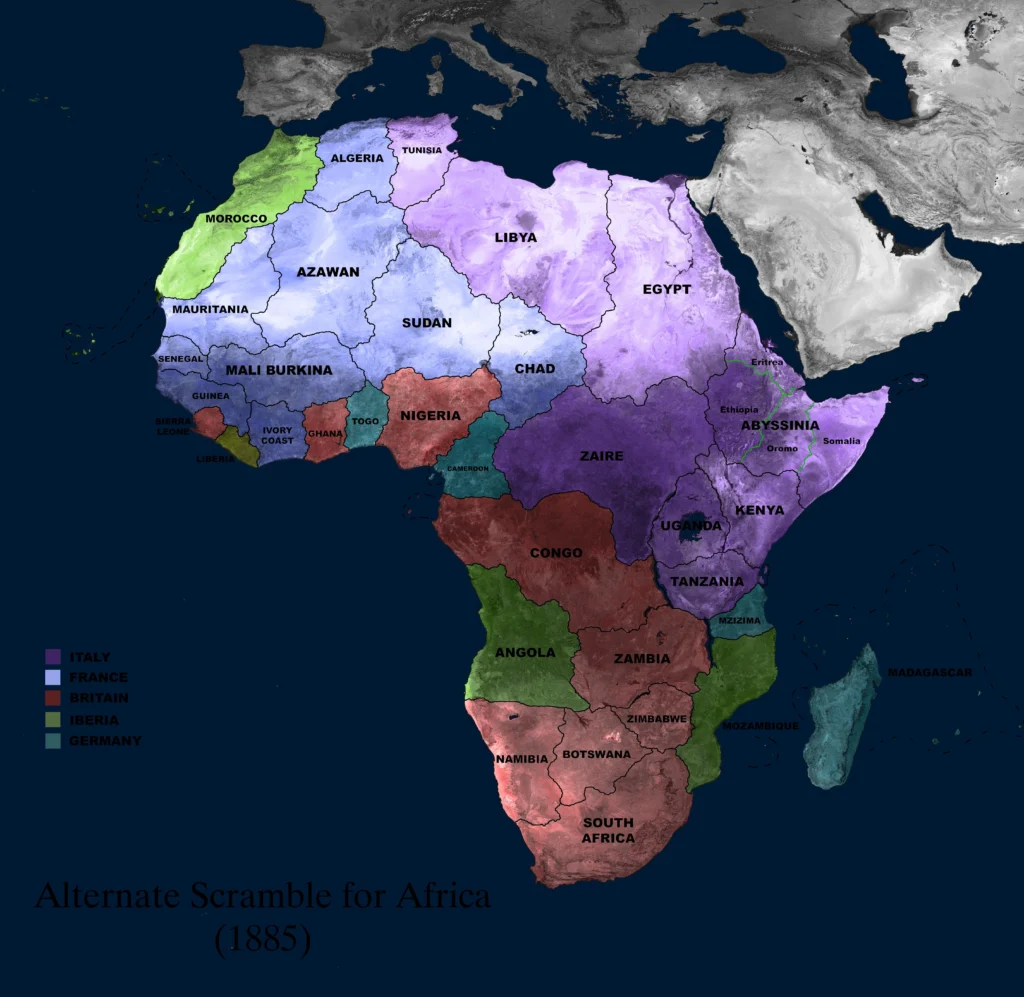Par Fiacre VIDJINGNINOU, PhD Sociologie Politique – Militaire, Chercheur Principal au Behanzin Institute (Lagos), Chercheur associé Sénior à Egmont Institute (Bruxelles)
Dans les salons feutrés de l’hôtel Terrou-Bi à Dakar, lors d’un récent colloque sur la sécurité régionale, un général ouest-africain lâchait à voix basse : « Nous ne sommes plus dans la gestion de crises, nous sommes dans la gestion de l’effondrement d’un système. » Formule brutale, peut-être excessive, mais qui capte quelque chose d’essentiel. L’Afrique entre dans une phase historique où tout semble à la fois fragile et irréversible. Fragile, parce que les lignes politiques, sécuritaires, économiques et sociales sont soumises à des chocs permanents. Irréversible, parce que les dynamiques enclenchées ces dernières années ont profondément transformé les rapports de force internes et externes du continent.
Derrière les discours officiels, les sommets diplomatiques et les communiqués rassurants, se dessine une Afrique plus dure, plus lucide, parfois plus brutale, mais indéniablement plus consciente d’elle-même. Ce qui frappe aujourd’hui, ce n’est pas tant l’ampleur des crises que leur enchevêtrement. Sécurité, souveraineté, gouvernance, démographie, ressources, influence internationale : tout se tient. Et c’est précisément dans ces zones de friction que se joue l’avenir immédiat du continent.
La fin des illusions libérales : quand l’AES enterre soixante ans d’intégration
Le cycle politique africain amorcé dans les années 1990 touche clairement à sa fin. La promesse d’une démocratisation linéaire, portée par les transitions post-guerre froide, s’est fracassée contre la réalité des États faibles, des élites prédatrices et des sociétés épuisées par l’attente. Le 28 janvier 2024 a matérialisé cette rupture : ce jour-là, le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent simultanément leur retrait de la CEDEAO. Pas une suspension, pas une protestation. Un retrait pur et simple.
Dans les chancelleries africaines, le choc est total. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, créée en 1975, incarnait l’un des rares succès tangibles de l’intégration régionale africaine. Son effondrement partiel n’est pas un accident diplomatique, c’est le symptôme d’un divorce ancien entre gouvernants et gouvernés. Ces coups d’État militaires en Afrique de l’Ouest et du Centre ne sont pas des accidents de parcours. Ils sont l’expression d’une colère populaire, d’une humiliation sécuritaire et du rejet des arrangements politiques jugés factices.
Ce qui fascine – et inquiète – dans la construction de l’Alliance des États du Sahel, c’est sa radicalité assumée. Les trois juntes ne se contentent pas de claquer la porte. Elles bâtissent méthodiquement une architecture alternative :confédération annoncée pour 2025, force militaire conjointe opérationnelle, projets de monnaie commune, passeport unifié. Bamako, Ouagadougou et Niamey savent pertinemment qu’ils n’ont ni les moyens économiques ni la profondeur stratégique pour tenir seuls. Mais ils font le pari que la légitimité populaire conquise par leur posture souverainiste compensera les déficits matériels.
Dans les couloirs du siège de la CEDEAO à Abuja, l’ambiance oscille entre déni et panique contrôlée. L’organisation a perdu d’un coup trois États membres, 72 millions d’habitants, et surtout sa crédibilité comme espace de régulation des crises. Les sanctions économiques imposées aux juntes ? Largement inefficaces, contournées via le Togo et la Guinée. La menace d’intervention militaire au Niger ? Abandonnée face au risque d’embrasement régional.
Cette rupture n’est pas synonyme de renaissance démocratique. Elle marque plutôt l’entrée dans une zone grise, où l’autoritarisme se pare de discours populaires et où la légitimité se mesure davantage à la capacité de tenir tête aux puissances étrangères qu’à celle de rendre des comptes aux citoyens. Le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye incarne parfaitement cette ambiguïté : officiellement fidèle à la CEDEAO qu’il préside, mais en pratique aligné sur nombre de revendications souverainistes. Faye a certes pris ses fonctions par les urnes en mars 2024, mais son programme – renégociation des contrats extractifs, remise en cause des bases militaires étrangères, discours sur la souveraineté monétaire – diffère peu de celui des colonels de Bamako.
Plus grave encore : la contamination idéologique progresse vers le sud. En Côte d’Ivoire, au Ghana, au Bénin, les opinions publiques – notamment les jeunesses urbaines – regardent avec une sympathie croissante les discours radicaux venus du Sahel. Les élites politiques traditionnelles, compromises par des décennies de médiocrité gestionnaire, ne comprennent pas que le problème n’est plus seulement économique. Il est existentiel.
L’économie en trompe-l’œil : croissance statistique, paupérisation réelle
Les institutions financières internationales continuent de publier des prévisions de croissance flatteuses pour l’Afrique subsaharienne : 4% en 2024, 4,2% en 2025. Ces chiffres alimentent les discours convenus sur « l’Afrique, continent d’avenir ». Mais quiconque circule entre Lagos, Kinshasa, Nairobi ou Abidjan perçoit immédiatement le décalage entre ces statistiques macro-économiques et la réalité vécue par des centaines de millions de personnes.
Sur le papier, l’Afrique continue d’afficher des taux de croissance respectables. Dans les faits, cette croissance reste largement déconnectée de la transformation structurelle des économies. Les exportations demeurent dominées par les matières premières. L’industrialisation avance lentement. L’emploi formel reste une denrée rare.
La RDC offre l’illustration parfaite de ce paradoxe. Le pays affiche des taux de croissance enviables, portés par l’explosion de la demande mondiale en cobalt et en cuivre. Les géants chinois, américains, européens se bousculent pour sécuriser leurs approvisionnements en minerais critiques. Kinshasa négocie des méga-contrats à coups de milliards de dollars. Et pourtant, dans les rues de Goma, de Lubumbashi, de Bukavu, la population s’enfonce dans une misère qui n’a rien de conjoncturel. Les infrastructures s’effondrent, les services publics sont inexistants, l’inflation dévore les revenus, pendant que les élites extractives – politiques, militaires, commerciales – accumulent des fortunes obscènes.
Le Kenya de William Ruto illustre une autre facette de cette schizophrénie économique. Nairobi s’est positionnée comme hub technologique régional, attirant investissements et talents dans les fintech, l’e-commerce, les services numériques. Les gratte-ciels poussent dans Upper Hill, les centres commerciaux flambants neufs attirent une classe moyenne émergente. Mais en juin 2024, cette même jeunesse qui incarne la modernité économique descend dans la rue pour protester contre une loi de finances jugée inique. Les manifestations font des dizaines de morts. Ruto est contraint de retirer son texte. Ce qui s’exprime dans ces révoltes, ce n’est pas seulement un refus fiscal, c’est un rejet viscéral d’un modèle de développement qui produit simultanément croissance et exclusion.
L’Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa incarne, elle, le spectre d’un déclin qui n’ose pas dire son nom. Première puissance industrielle du continent, l’économie sud-africaine stagne, plombée par des coupures d’électricité chroniques (le “loadshedding”), une corruption systémique héritée de l’ère Zuma, un chômage des jeunes frôlant les 60%. Les élections de mai 2024 ont sanctionné l’ANC, parti historique de la libération, en le privant pour la première fois de sa majorité absolue. Ramaphosa gouverne désormais en coalition avec la Democratic Alliance, alignement contre-nature qui satisfait les marchés financiers mais exaspère la base militante.
Les grandes annonces sur la Zone de libre-échange continentale africaine suscitent de l’espoir, mais leur mise en œuvre se heurte à des résistances nationales, à des infrastructures déficientes et à des administrations peu préparées. Le marché africain existe dans les discours. Il peine encore à exister dans la réalité quotidienne des entreprises et des consommateurs. Les barrières non tarifaires subsistent, les infrastructures de transport inter-africaines restent dérisoires, les monnaies nationales inconvertibles entre elles compliquent tout commerce intra-continental.
Dans plusieurs capitales, les décisions économiques se prennent désormais sous contrainte budgétaire sévère. La dette est redevenue un instrument de pression. Les négociations avec les institutions financières internationales se font dans un climat de méfiance mutuelle. Les États veulent plus de marge de manœuvre. Les bailleurs exigent plus de discipline. Entre les deux, les populations subissent l’inflation, la hausse du coût de la vie et l’érosion des services publics.
Le jihadisme comme horizon indépassable : l’extension silencieuse de la guerre
Dans les états-majors des armées ouest-africaines, une évidence s’impose désormais : la guerre contre les groupes jihadistes au Sahel n’est pas gagnée. Pire, elle est probablement ingagnable avec les moyens et les stratégies actuels. Sur le plan sécuritaire, le continent vit une guerre diffuse, fragmentée, souvent invisible aux yeux du grand public international. Le Sahel reste l’épicentre de cette violence, mais ses ondes de choc s’étendent désormais vers les pays côtiers. Le golfe de Guinée, longtemps considéré comme un espace relativement stable, est aujourd’hui sous pression.
Quinze ans après la création d’AQMI, dix ans après la conquête du nord du Mali par les jihadistes en 2012, cinq ans après l’intensification de l’insurrection au Burkina Faso, la situation sécuritaire n’a jamais été aussi dégradée. JNIM, la coalition menée par Iyad Ag Ghali et affiliée à Al-Qaïda, contrôle désormais de vastes portions du Mali central, du nord-est du Burkina Faso, et étend ses tentacules vers le sud, menaçant directement le Bénin, le Togo, le nord de la Côte d’Ivoire et du Ghana.
Les groupes jihadistes ne gagnent pas seulement par les armes. Ils gagnent par la lente érosion de l’État. Là où l’administration est absente, là où la justice est inaccessible, là où l’armée est perçue comme étrangère aux populations, l’insurrection s’installe. Mais ce qui a changé, c’est la nature même de cette présence jihadiste. Les katibas de JNIM ne se contentent plus de mener des attaques asymétriques. Elles administrent, taxent, rendent la justice, organisent les marchés, régulent les conflits fonciers. Dans certaines zones, elles exercent une forme de gouvernance plus prévisible et moins prédatrice que celle des États officiels.
Cette évolution vers ce qu’on pourrait appeler un “jihadismede gouvernance” déjoue toutes les stratégies contre-insurrectionnelles classiques. Comment reconquérir militairement des populations qui, sans adhérer idéologiquement au projet jihadiste, ont développé des formes d’accommodation pragmatique avec les groupes armés ? Les offensives militaires, menées par des armées nationales souvent indisciplinées et violentes envers les civils, ne font qu’alimenter le ressentiment et pousser davantage de jeunes dans les bras des insurgés.
Plus inquiétant encore est l’hybridation croissante entre criminalité transnationale et violence idéologique. Trafic de drogue, d’or, de carburant, de migrants : la guerre est devenue une économie. Elle nourrit des réseaux qui prospèrent sur le chaos et qui n’ont aucun intérêt à son extinction. Cette réalité est connue des services de renseignement africains. Elle est moins assumée dans les discours publics.
Le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré illustre l’impasse. Arrivé au pouvoir par un coup d’État en septembre 2022, Traoré a fait du combat contre le jihadisme son obsession. Il a rompu avec la France, expulsé les forces spéciales françaises, fait venir des “instructeurs” russes, multiplié les recrutements dans l’armée, armé des dizaines de milliers de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Résultat ? Le territoire contrôlé par l’État burkinabè se réduit comme peau de chagrin. Plus de deux millions de déplacés internes. Des massacres de civils récurrents, parfois perpétrés par les forces gouvernementales elles-mêmes. Une économie en chute libre. Et une popularité de Traoré qui, paradoxalement, reste élevée, portée par un nationalisme exacerbé et un discours anti-impérialiste qui résonne auprès de populations désespérées.
Au Mali, la présence du groupe Wagner/Africa Corps, censée changer la donne militaire, produit des résultats mitigés. Certes, quelques succès tactiques ponctuels. Mais globalement, les mercenaires russes se comportent avec la même brutalité que celle dénoncée chez leurs prédécesseurs français, multipliant les bavures contre les civils, alimentant les cycles de vengeance.
Le plus inquiétant reste la descente inexorable vers le sud. Le Bénin, pays longtemps épargné, subit désormais des attaques régulières dans ses parcs nationaux du nord. Patrice Talon en situation de politique intérieure tendue, tente de répondre par un double jeu : militarisation accrue des zones frontalières et stratégie de soft power culturel visant à positionner Cotonou comme hub diplomatique stable de la région. Mais le vernis craque. Les enlèvements se multiplient, les incursions jihadistes se font plus audacieuses, et l’armée béninoise, se repositionne plutôt difficile face à la menace.
L’Afrique comme champ de bataille global : la nouvelle ruée diplomatique
Jamais le continent n’a été aussi courtisé. États-Unis, Chine, Russie, Turquie, pays du Golfe, Union européenne : tous veulent une part de l’Afrique. Cette ruée n’est pas philanthropique. Elle est stratégique. Ressources, votes aux Nations unies, bases militaires, corridors commerciaux : l’Afrique est redevenue un espace central de la compétition mondiale.
Ce qui a changé, c’est la posture africaine. Les dirigeants africains négocient désormais avec plus d’assurance, parfois avec cynisme. Ils diversifient leurs partenaires, jouent sur les rivalités, refusent les injonctions morales trop visibles. Cette diplomatie transactionnelle est souvent présentée comme un signe de maturité. Elle comporte aussi des risques, notamment celui de substituer une dépendance à une autre.
La fin progressive de certaines présences militaires occidentales n’a pas signifié la fin de l’ingérence extérieure. Elle a simplement modifié ses formes. Conseillers, mercenaires, accords de défense opaques : la guerre se privatise, la souveraineté se fragmente. Ce qui se joue dans ces recompositions dépasse les discours sur la multipolarité. C’est une reconfiguration profonde des chaînes d’influence, où chaque puissance étrangère cherche à sécuriser ses intérêts tout en ménageant des régimes de plus en plus imprévisibles.
Une jeunesse sous pression, entre révolte et résignation
Le véritable cœur battant de l’Afrique reste sa jeunesse. Une jeunesse nombreuse, connectée, impatiente, souvent désillusionnée. Elle ne croit plus aux promesses politiques classiques. Elle se mobilise autrement, parfois de manière spontanée, parfois violente, parfois silencieuse.
Les réseaux sociaux ont transformé le rapport au pouvoir. Ils exposent les abus, accélèrent les colères, mais créent aussi des illusions de changement rapide. Beaucoup de jeunes oscillent entre l’engagement local et le désir de partir. La migration n’est pas seulement une fuite. Elle est devenue un projet rationnel dans des contextes où l’avenir semble bouché.
Les élites africaines sous-estiment encore la profondeur de ce malaise générationnel. Gouverner une population jeune avec des schémas anciens est une équation vouée à l’échec. Dans les manifestations kenyanes de juin 2024, dans les soulèvements numériques au Nigeria, dans l’adhésion passive aux discours des juntes sahéliennes, c’est la même lassitude qui s’exprime : celle d’une génération qui refuse d’attendre son tour dans un système qui ne produit que de l’exclusion.
Le retour des identités : religion et culture comme refuges
Dans ce contexte de tensions multiples, on observe un retour marqué des références identitaires, religieuses et culturelles. Elles offrent du sens là où l’État en fournit peu. Elles structurent des solidarités, mais peuvent aussi nourrir des fractures.
L’islam et le christianisme, sous leurs formes diverses, jouent un rôle central dans la recomposition sociale. Ils ne sont pas seulement des croyances ; ils sont des cadres de socialisation, d’entraide et parfois de mobilisation politique. Ignorer cette dimension, c’est passer à côté d’un levier fondamental de compréhension du continent. Les pentecôtismes flamboyants qui quadrillent les villes, les confréries soufies qui résistent au salafisme jihadiste, les mouvements évangéliques qui prospèrent sur les fractures sociales : autant de réponses à un vide que les États n’arrivent plus à combler.
Une Afrique lucide mais fatiguée, qui refuse les récits extérieurs
Ces trois ruptures – géopolitique, économique, sécuritaire – ne sont pas indépendantes. Elles s’alimentent mutuellement, créant une spirale dont il est difficile d’anticiper l’issue. L’effondrement de la CEDEAO affaiblit les réponses collectives aux crises sécuritaires. La persistance de modèles économiques exclusifs nourrit les frustrations qui alimentent soit les insurrections jihadistes, soit les coups d’État militaires. L’enlisement sécuritaire détruit les conditions du développement économique et radicalise les postures politiques.
Pour autant, céder au catastrophisme serait une erreur d’analyse. L’Afrique de 2024-2025 ne s’effondre pas uniformément. Elle se recompose, selon des lignes de fracture inédites. Des pays comme le Rwanda, le Ghana, la Côte d’Ivoire maintiennent des trajectoires de stabilité relative et de croissance tangible. Des sociétés civiles, notamment les jeunesses urbaines connectées, expérimentent de nouvelles formes de mobilisation politique qui dépassent les clivages ethniques traditionnels. Des entrepreneurs africains lèvent des fonds colossaux, créent des emplois, intègrent les chaînes de valeur mondiales sans passer par les circuits de l’aide au développement.
L’Afrique d’aujourd’hui n’est ni celle des discours catastrophistes ni celle des récits euphoriques. C’est un continent lucide, parfois désabusé, mais toujours en mouvement. Les sociétés africaines savent que les solutions ne viendront pas uniquement de l’extérieur. Elles savent aussi que les élites locales portent une part majeure de responsabilité.
Ce qui émerge, c’est un continent fragmenté, où la notion même d’“Afrique” comme ensemble cohérent perd progressivement son sens. Entre le Rwanda de Kagame et la RDC de Tshisekedi, entre le Ghana démocratique et le Mali des colonels, entre le Nigeria qui implose lentement et le Botswana qui prospère tranquillement, quel dénominateur commun subsiste-t-il encore ?
La question centrale n’est plus de savoir si l’Afrique va émerger, mais à quel prix social, politique et humain cette émergence se fera. Les prochaines années seront décisives. Elles diront si le continent parvient à transformer ses crises en opportunités ou s’il s’enferme dans une instabilité chronique, gérée au jour le jour.
Ce qui est certain, c’est que l’Afrique n’est plus périphérique. Elle est au cœur du monde qui vient. Et le monde ferait bien de la regarder autrement que comme un problème à gérer ou un marché à conquérir. Les Africains eux-mêmes l’ont compris bien avant les observateurs extérieurs. Ils expérimentent, improvisent, résistent, s’adaptent. Sans certitude, sans garantie, mais avec une lucidité qui manque cruellement aux discours convenus de ceux qui, depuis leurs bureaux climatisés, continuent de plaquer sur le continent des grilles d’analyse périmées.